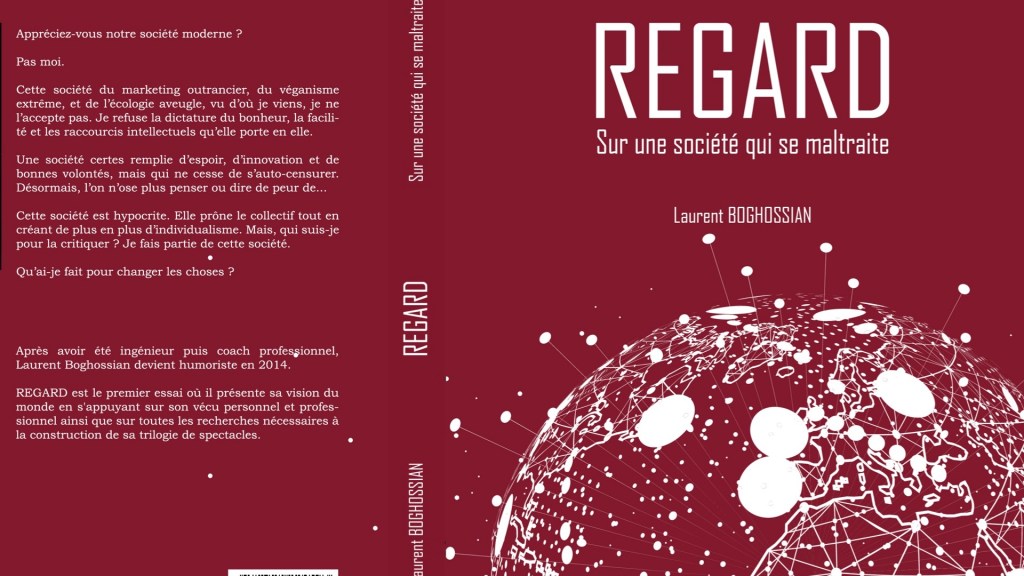
Conceptuel
Comme beaucoup de français, je pense pouvoir dire que je suis issu d’une tradition profondément terrienne et ancrée dans la réalité. Non pas que ma famille fût paysanne, mais simplement confrontée à une réalité de vie brute et sans fard dans une ville qui pouvait l’être tout autant.
Mon arrière-grand-mère maternelle, originaire de Lombardie, est venue en France à douze ans après plusieurs jours de voyage sans manger. À son arrivée à Marseille, elle s’est assise sur les marches du grand escalier de la Gare Saint- Charles où elle patienta plusieurs heures. Un homme s’est alors approché d’elle lui demandant ce qu’elle faisait. Puisqu’elle ne parlait pas français, elle lui montra un bout de papier cousu sur son manteau, sur lequel étaient écrites les coordonnées de la pension où travaillait sa grande sœur, arrivée en France quelques mois auparavant. Cet inconnu l’a alors accompagnée pour retrouver sa sœur à l’adresse indiquée.
Je raconte cela pour exprimer que toute mon histoire est avant tout basée sur des réalités fortes. Ce genre d’histoire imprègne votre âme. Vous ressentez la dureté des choses. Cette rudesse vous est transmise presque inconsciemment, elle vous habite. Elle vous ramène systématiquement à des choses réelles et bien concrètes. Des milliers de français pourraient raconter eux aussi cette histoire-là. Des migrants arrivant en France aujourd’hui ou dans d’autres pays d’Europe pourraient vous raconter cette même histoire faite de vérités brutes, concrètes et ancrées dans la réalité. Dans mon cas, cette histoire est amplifiée par des émotions et des sensations connectées à la nature et à la matière. Des sensations que j’ai vécues en tant qu’enfant, notamment grâce à mon père et à tout ce qu’il m’a transmis.
Mon père m’a emmené toute mon enfance, ainsi que mon adolescence, dans son camion. Nous allions sur les chantiers qu’il devait mener pour ses clients. J’ai gâché du mortier à la pelle à n’en plus sentir mes poignets. J’ai poncé des façades à m’en remplir les sinus de poussière. J’ai travaillé en plein soleil en été sous 40° de température, et sous la pluie pendant les vacances d’hiver. J’ai circulé, dormi et mangé dans un camion de maçons avec mon père au volant, un ouvrier et un manœuvre assis à côté de moi, et bien sûr toutes les effluves corporelles qui vont avec. J’ai toujours vécu dans une réalité on ne peut plus humaine faite de sensations sans fard.
Côté loisirs, alors que je n’avais que cinq ans, mon père me mettait un masque et un tuba sur la tête pour aller au fond de l’eau ; à même pas dix ans, il m’avait appris à lancer le couteau sur les pins de la Côte Bleue, à l’ouest de Marseille. Tout cela pour que je n’aie pas peur de l’inconnu. Je touchais du doigt la faune et la flore marine dans moins d’un mètre d’eau, je vidais des poissons alors que je ne savais pas encore nager. Il m’a appris la plongée en apnée ainsi que la chasse sous-marine et j’ai encore le souvenir de lui sortant de l’eau avec un poulpe de 4 ou 5 kg qu’il venait d’attraper, encore vivant, et qui lui remontait tout le long de l’épaule et du torse. Tout cela pour dire que chez nous, les sensations étaient vivaces, directes et brut de décoffrage. Si ma famille n’avait pas émigré d’Arménie, je crois que nous serions devenus trappeurs ou bûcherons. Plus tard, à un autre niveau, avant de devenir ingénieur, je fus animateur dans une centre social, toujours dans les quartiers nord de
Marseille, où j’ai pu toucher du doigt la réalité de plusieurs formes de misère.
C’est cet héritage construit sur des sensations fortes, des vies âpres, avec des tempéraments rugueux et on ne peut plus organiques, qui fait que je ne peux plus supporter le fantasme sociétal moderne devenu un concept mielleux et qui, je pense, est en train de nous éloigner de notre humanité. Ce fantasme sociétal se reflète, par exemple, dans des expressions comme « Belle année 2020 ». C’est ce message que j’ai pu lire en début d’année sur un panneau 4*3. Je me suis demandé ce que cela signifiait que de passer une « belle » année. C’est comme le fameux « Belle journée » que l’on reçoit généralement par mail au travail. Vous imaginez l’ambition ? Il faut que la journée soit belle. Sujet de philo : « Définir le beau ». Vous avez 3 heures.
Normalement, l’on se souhaite une « bonne » journée. Comme un bon repas. On ne s’est jamais souhaité un « beau » repas, non ? C’est normal, le mot « bon » renvoie à l’univers des sensations, d’abord celui du goût, mais aussi à d’autres niveaux du monde physique. Lorsque l’on souhaite une « bonne » journée, c’est une journée chargée d’énergie, d’intensité, de moments forts, de satisfaction que l’on souhaite. Alors bien sûr, cela n’est pas toujours le cas. La journée contiendra parfois de la frustration, du doute, de la désespérance, de la démotivation. Bref, une journée humaine. Tout cela sera ancré dans des sensations concrètes, émotionnelles et donc connecté à un quotidien terrestre.
Mais qu’en est-il d’une « belle » journée ? Non, vraiment je ne vois pas. Si ce n’est que nous entrons là dans le domaine de la beauté. Du superficiel donc ? La personne qui nous souhaite une « belle » journée nous souhaite donc une journée d’apparences, une journée idéalisée et fantasmée.
Belle en apparence mais pas connectée à ce que l’on vit vraiment.
Comme dans un rêve ou une image d’enfance, l’interlocuteur, chargé d’une pseudo-bienveillance dégoulinante, nous souhaite d’avoir une journée de surface, quasiment impalpable : très belle, très douce, très cosy, très chaleureuse, très jolie, très mimi… beeeuuuuurrrrrrrrrrrk !
Il n’y a pas plus puéril et manipulateur que ce genre de discours. Les gens sont parfois tendus, stressés ou frustrés mais ils vous souhaitent une beellllllleeeee journée. Cela me fait penser aux membres d’une secte lorsqu’ils se croisent : « Aoum, oh oui frère, belle journée à toi. » Une « belle » journée n’est finalement qu’un moment issu d’un fantasme, où tout se passerait bien mais dans une forme de légèreté aérienne.
Les gens qui nous souhaitent une « belle année », ou une « belle journée » sont comme des enfants apeurés par de vraies sensations. Ils savent parler des émotions mais ils ne savent pas les traverser. Ce sont souvent des gens qui ne se confrontent pas vraiment aux réalités de notre monde. Ils le vivent à distance, par procuration, au travers de livres de développement personnel ou de keynotes TED. Ils vous parlent de collectif mais travaillent seuls chez eux. Ils idéalisent une vie qui ne cognerait pas. Et oui, la vie ça cogne aussi, parfois. Ils pensent leurs émotions, mais ils ne les traversent pas toujours réellement. Alors, bien sûr, vous pourriez vous dire : « Mais qu’est-ce qu’on en a à faire Laurent ? » Comme je vous comprends.
Deux minutes, j’ouvre mes chakras.
Là où je veux en venir c’est que tout ce fantasme de belle vie, de belle année, de belle société, est en train de se répandre au point où tout ce qui n’est pas parfait, devient un problème. Nous touchons ici le cœur de la bienpensance et du politiquement correct. Si c’est un peu rugueux et pas assez lisse, on passe directement au procès d’intention. « Il a mis le mot homme avant le mot femme, misogyne ! Il a dit noire, raciste ! Ah non, mince il parlait d’une tablette de chocolat. Arrghhhh, ce n’est pas possible. Il faut que ce soit parfait, parfait, je suis choqué.e, je suis outré.e, c’est une honte, une honte. Je m’insurge. Il faut punir. »
Calme-toi. Même au pays des bisounours, la perfection n’existe pas. Au pays de la perfection, les « belles journées » sont reines. Nous pourrions être tentés d’imaginer que la vie se passe réellement comme lorsque nous regardons une émission sur France 2 qui montre une star qui quitte une tribu du bout du monde, après avoir vécu quinze jours avec elle. Ceci n’est pas une émotion. C’est juste de la sensiblerie. Une émotion, une vraie – la joie ou la tristesse – peut vous terrasser physiquement. Mais là, on n’est pas atteint physiquement. On se dit quoi devant ce reportage ? « Ohhhh, c’est beau. » Et nous voilà de retour dans l’univers du beau, du superficiel. Et cela se répand à tout, avec l’idéalisation, la culpabilité et la performance qui vont avec.
Vraiment, je déteste le concept organisé dans lequel nous vivons et qui nous amène finalement à définir nos vies au travers d’un fantasme plutôt que de choses concrètes. Cette vie conceptuelle qui fait que désormais, on ne commande plus un café allongé, mais un café américain. Un café allongé, c’est du café avec de l’eau en plus. Alors qu’un café américain, alors là… on touche au rêve. Parce que c’est ça le but de la vie ? Rêver ? D’ailleurs, le café ne nous est plus vendu en tant que tel mais plutôt comme « un délice caféiné révélateur de plénitude ». Un délice caféiné ? C’est amer, le café et c’est pour ça qu’on l’aime. Au rayon des débilités mercantiles, il y a aussi le café latte. En résumé : du café avec du lait. À une époque, on appelait ça du café au lait. Parfois même il y avait de la crème en surface du lait. Mais bon, café au lait, ça fait boisson de prolétaire franchouillard. Et c’est vrai que, ma grand-mère, elle en buvait souvent, du café au lait. Mais juste parce que dans les années 50 cela permettait de sauter un repas et remplissait le ventre à moindre coût.
Alors que le café latte, c’est bien plus noble. Déjà, on le paye plus cher, c’est tendance. Et puis au moins, café latte, c’est compréhensible dans tous les pays. Même à Champognoux- Les-Mimosas, quand tu commandes un café latte, tu as l’impression d’être à New York. Non vraiment, c’est un délire absolu que ce marketing de la vie dans lequel nous baignons.
Alors c’est sûr qu’au départ, on se laisse avoir, car c’est assez flatteur que d’être accueilli de manière personnalisée dans un bar ; non, pardon, dans un coffee shop. On se la raconte, on se sent un peu plus riche et même un peu plus intelligent. Surtout si des livres en anglais ont été placés ici et là sur une étagère. C’est tellement agréable que de traverser un espace zen, respectueux de l’environnement où des produits équitables nous seront servis dans le respect des valeurs de l’humanittéééééé. Beurk!
Tout cela est superficiel, sans réel ressenti. Ou plutôt non : un ressenti cosy où l’on se sentira à l’abri, comme une caresse apaisante, confortés dans nos idées et dans nos certitudes. Ce sera très « sympa » comme ambiance. C’est d’ailleurs dans cet univers que nous pourrons penser à l’injustice du monde, à l’écologie ou à notre prochain séjour bien-être. Surtout que nous irons entre amis, ces gens formidables qui pensent comme nous et qui nous rassurent sur le fait que nous avons raison. Vous croyez que j’attaque là les bobos ? Mais bien sûr que non : nous sommes tous touchés par ce genre de comportement et l’on ne s’en rend même plus compte. C’est la société de l’idéal et de l’ego concentré : il faut absolument chercher à atteindre cet idéal de monde parfait car nous sommes en charge de la survie de ce monde.
Tout a été fait, et nous l’avons accepté, pour que nous n’ayons plus à nous confronter aux réalités concrètes. Et puis cela nous arrange bien de ne pas voir certaines réalités. Les gens vivant la misère ou la guerre, eux, pourraient nous en parler. Je pense plutôt qu’ils auraient envie de nous mettre des claques. Mais nous ne voulons pas entendre ça. Non, nous voulons vivre une aventure et devenir le héros de nos vies. Bon une aventure avec le soleil, le sable et la mer et pas l’aventure avec le mal de mer, les brûlures et les scorpions. Ah bon et pourquoi ? Mais parce que le confort a fait de nous des gens fragiles.
Qui a le courage d’aller aider cette jeune fille qui se fait importuner dans les transports en commun par plusieurs garçons ? Qui a le courage de dire à ce jeune homme de lever ses pieds de la banquette dans le métro ? Oh oui, on le regarde méchamment en fronçant les sourcils pour qu’il comprenne. Tu parles d’un courage. On espère juste que quelqu’un d’autre le fasse pour nous et si cela ne se produit pas nous dirons : « J’ai préféré ne pas m’énerver parce que sinon, j’aurais pu tout péter. » Ben voyons. Et tu allais t’énerver comment ? Avec un double coup de sourcil ?
Nous pensons nos émotions, nos ressentis, mais nous sommes de moins en moins équipés émotionnellement et sensoriellement pour encaisser la vie dans tous ses aspects. Nous avons compris beaucoup de choses, mais qu’a-t-on expérimenté réellement ? Nous y réfléchirons plus tard, dans notre monospace ovoïde, véritable utérus roulant, dont on n’espère ne pas avoir à en sortir. Et comme nous devenons de plus en plus sensibles, avec un épiderme de plus en plus fin, nous allons nous remplir de certitudes. Comment cela ? Mais avec une masse d’informations et un flux permanent de sollicitations qui nous permettront de ne plus être connectés à notre essence profonde et d’être dans l’intellectualisation permanente de ce qui se passe.
Malheureusement, pour les jeunes générations cela devient un mode de vie. Une base de référence. Aller vite, zapper et savoir tout un tas de choses sans réfléchir en profondeur permet deux choses : amalgamer sans recul des concepts qui n’ont rien à voir entre eux, et projeter un idéal impossible à atteindre. Et s’ils n’y arrivent pas : frustration, jugement, exécution.
Remarquez, je me demande finalement si cela ne concerne que les plus jeunes d’entre nous.
